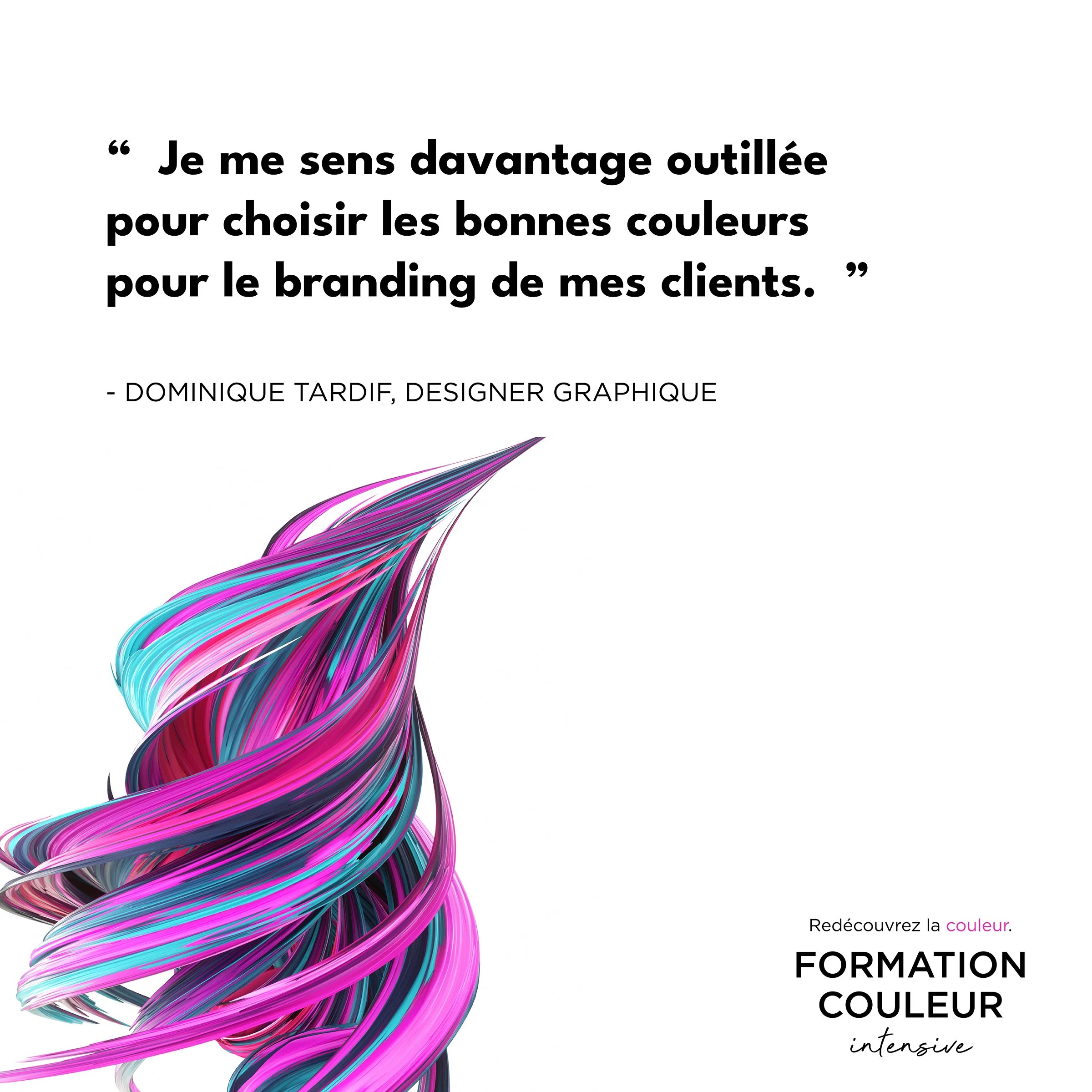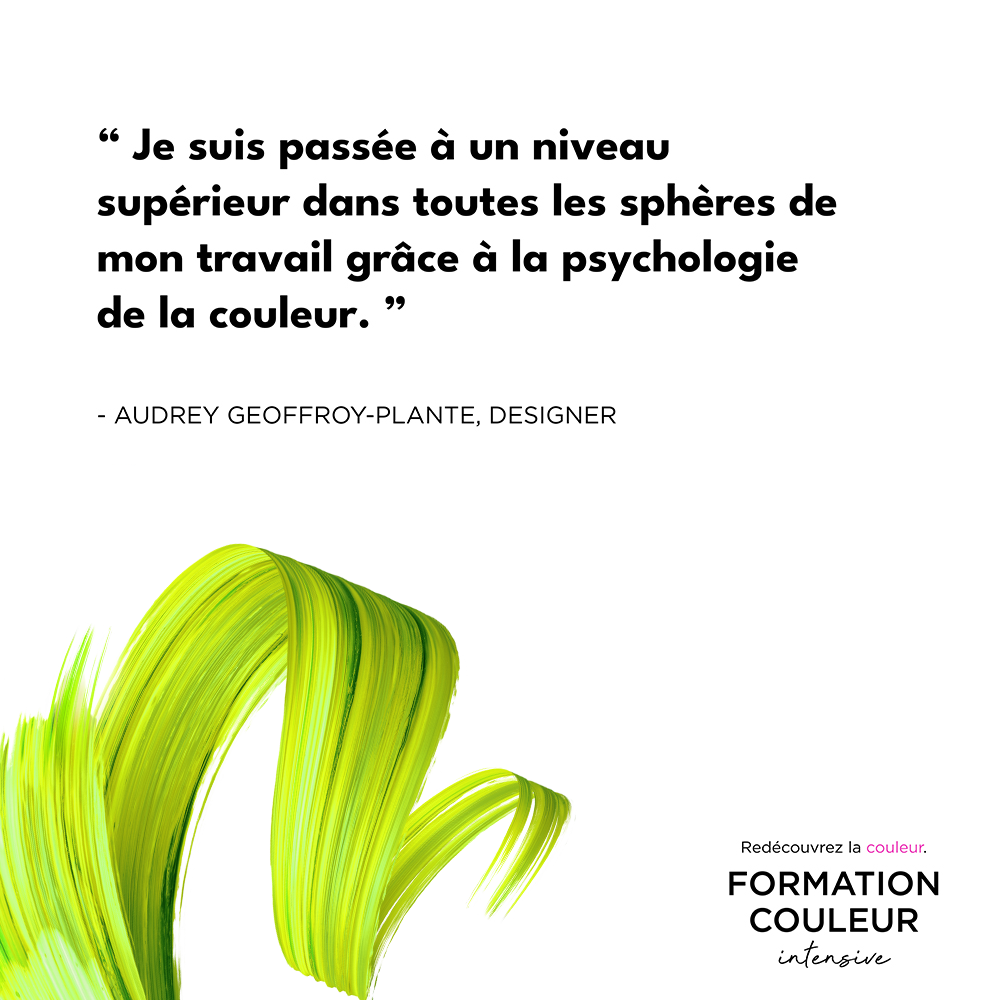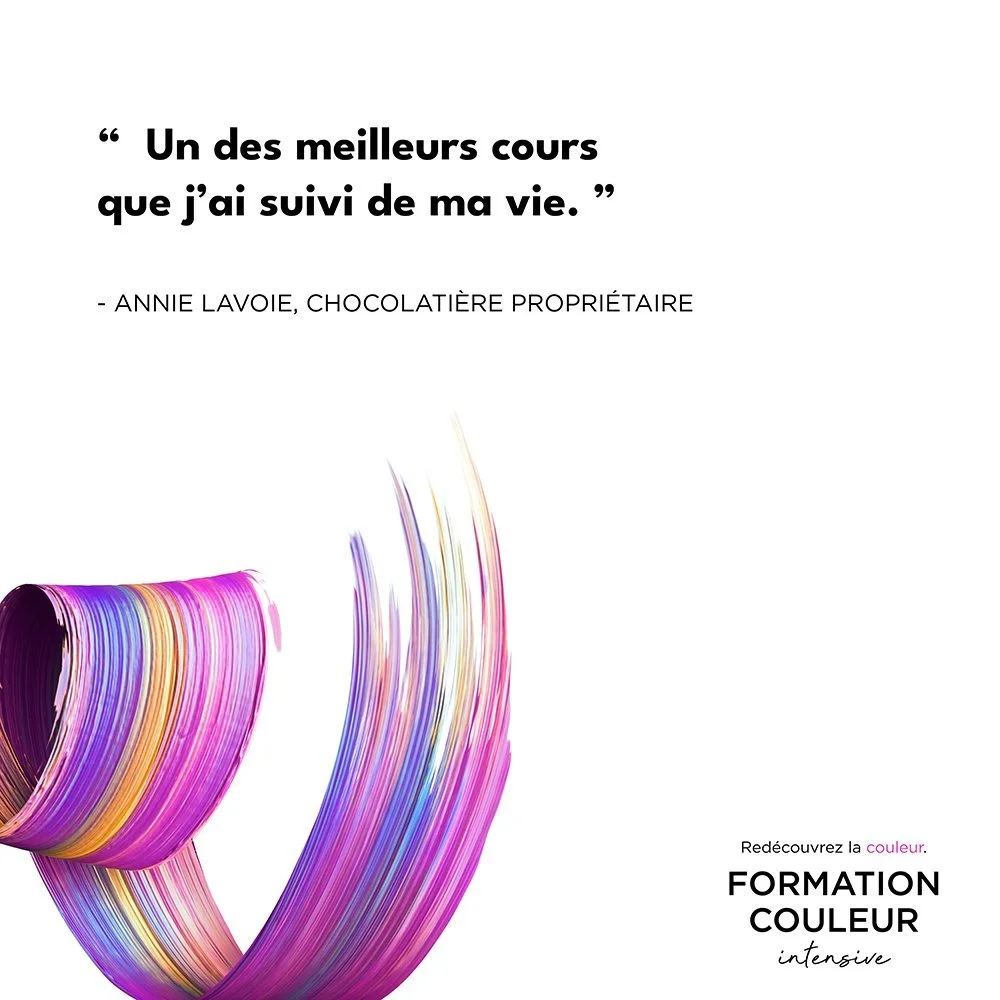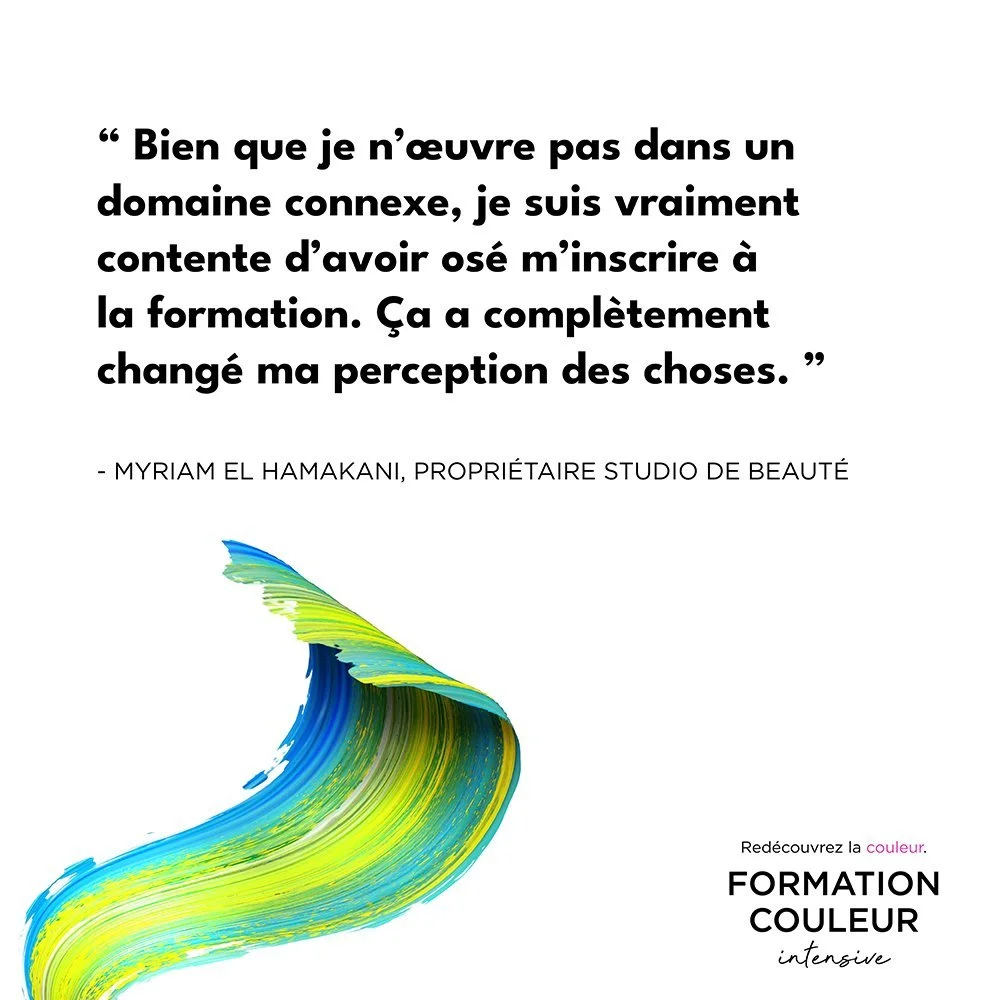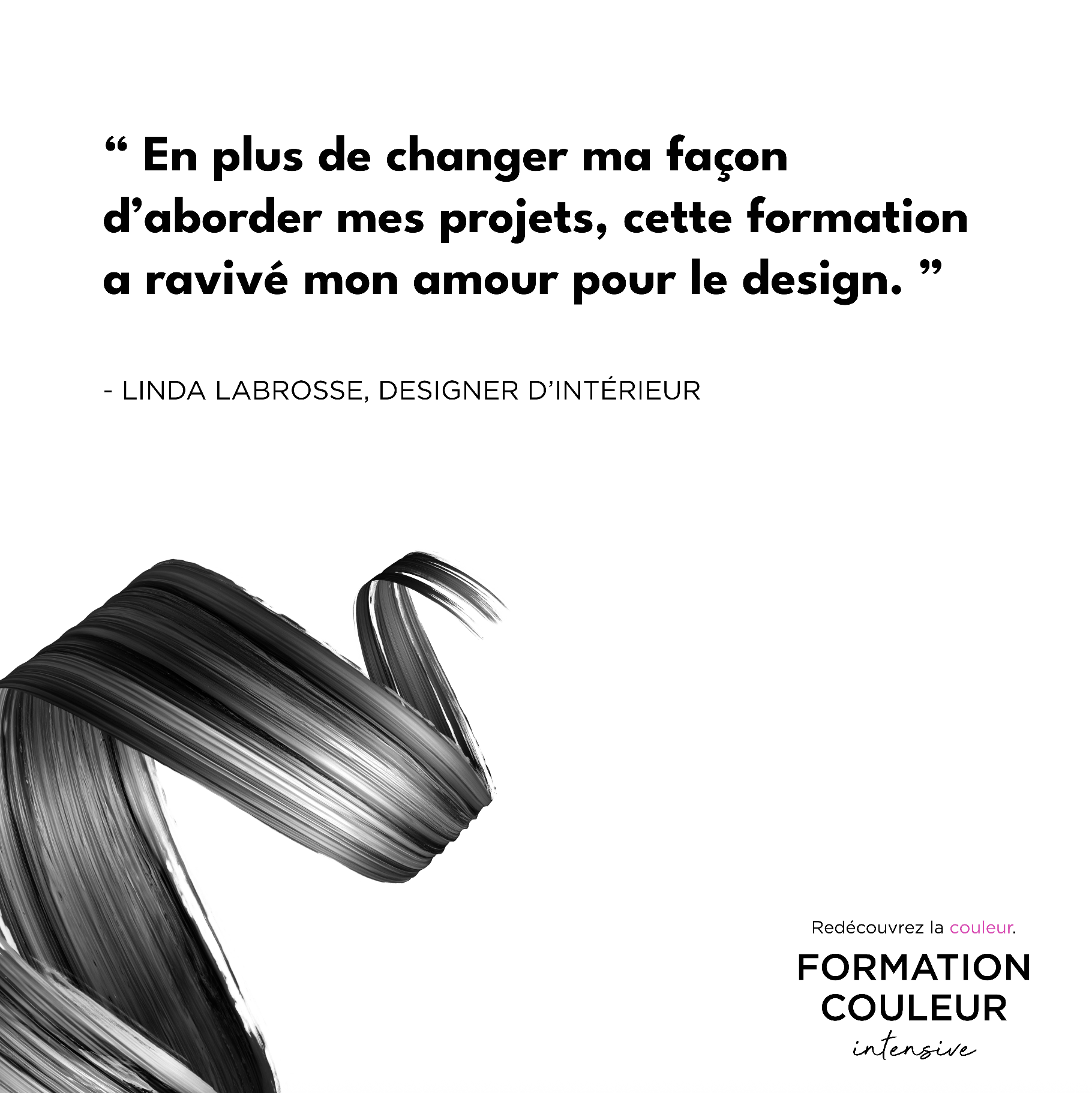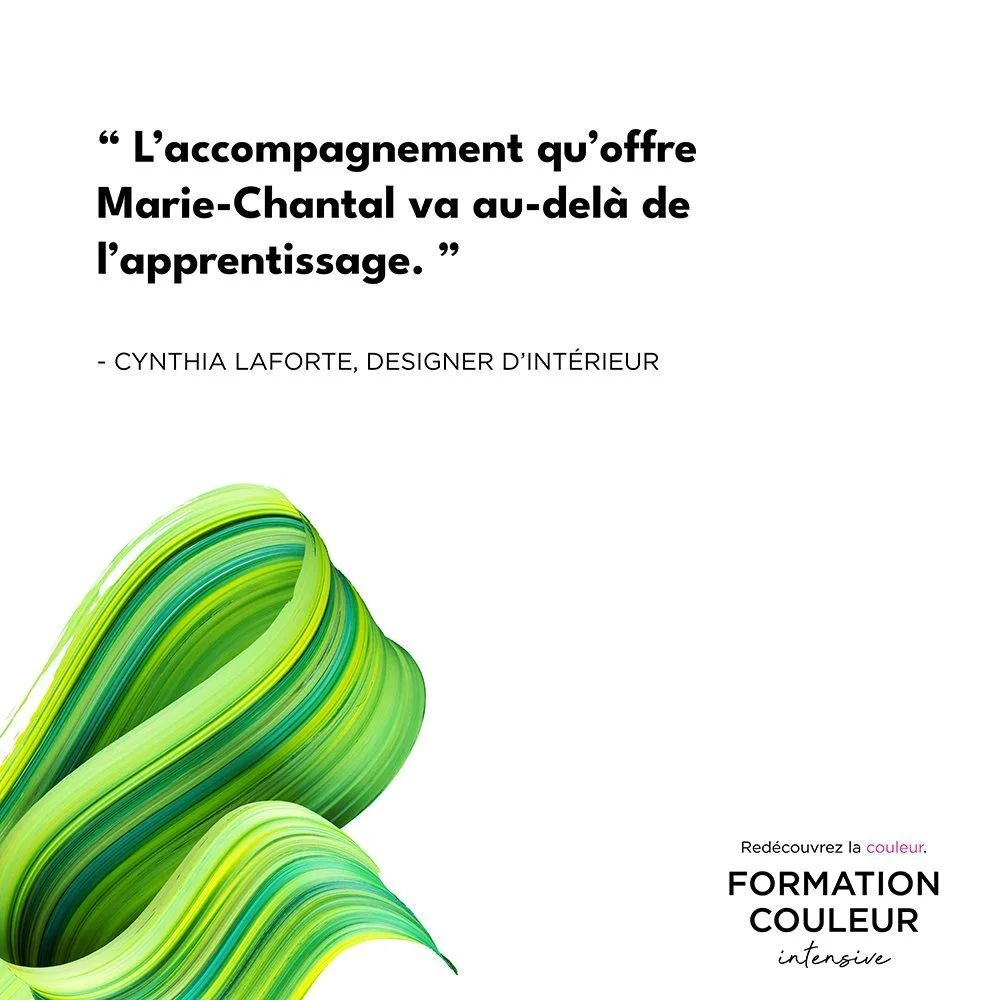La place de la couleur en milieu hospitalier
On retrouve beaucoup de blanc en milieu hospitalier. C’est blanc, c’est propre, c’est stérile. Mais est-ce que cela élève réellement le bien-être du personnel médical et des usagers? La question mérite d’être posée. Si le blanc évoque à première vue la propreté et la neutralité, il ne faut pas oublier que les hôpitaux ne sont pas que des lieux de soins physiques: ils sont aussi des espaces profondément humains, où les émotions, les inquiétudes et l’attente se côtoient quotidiennement. La couleur, omniprésente dans notre environnement, a un impact réel sur notre physiologie et notre état d’esprit. Alors, pourquoi persiste-t-on à croire que le blanc est le choix le plus approprié pour ces lieux si chargés d’émotions?
Le mythe du blanc pur
Le blanc a longtemps été associé à la propreté, à la pureté et à la maîtrise du risque de contamination. Dans un environnement médical, ces associations semblent évidentes et légitimes. Pourtant, lorsqu’il est omniprésent, il est loin d’être un allié. Trop de blanc crée un vide sensoriel. Dans un endroit où l’on se rend pour des raisons de santé, souvent empreint d’inquiétudes ou de maux, ce vide peut renforcer l’angoisse plutôt que de l’apaiser. Le blanc, froid et stérile, ne rassure pas: il isole, en effaçant toute chaleur humaine et tout repère émotionnel. Un environnement hospitalier devrait être aussi chaleureux, rassurant et apaisant que fonctionnel. En colorimétrie, on sait depuis longtemps que les teintes plus douces, plus enveloppantes, favorisent la détente et réduisent le stress. Le blanc, au contraire, peut rappeler le vide, la perte, le vertige que peut représenter la maladie.
Fatigués du blanc
Le blanc pur, particulièrement lorsqu’il est appliqué sur des surfaces réfléchissantes, peut provoquer une réelle fatigue oculaire. En effet, le blanc contient toutes les couleurs du spectre lumineux, ce qui demande un effort constant à l’œil pour s’adapter. Cet éblouissement subtil mais continu peut contribuer à une baisse de concentration et à des erreurs plus fréquentes — un fait documenté dans plusieurs études sur la performance visuelle en milieu clinique.
J’ai récemment pu confirmer ce phénomène lors d’une visite dans un bureau médico-esthétique où la salle d’examen était entièrement blanche. Intriguée, j’ai demandé à l’infirmière comment elle se sentait dans cet environnement. Elle m’a répondu, presque surprise de l’admettre, qu’elle travaillait dans deux cliniques, mais que dans celle-ci, elle ressortait toujours plus fatiguée, parfois même avec des maux de tête. Je n’ai pas eu à chercher bien loin la cause: la réflexion excessive du blanc pur sur toutes les surfaces sollicitait son système visuel sans répit.
La perception du blanc chez les aînés
Chez la population vieillissante, le blanc pur et les surfaces brillantes sont également à éviter. Les personnes âgées perçoivent souvent les teintes pâles plus jaunâtres certes, mais cela peut altérer leur perception de certains contrastes qui, pour les plus jeunes, semblent évidents et accroître la confusion visuelle. De plus, un LRV (Light Reflectance Value) trop élevé peut créer des reflets et des éblouissements gênants, particulièrement pour ceux souffrant de maladies cognitives ou visuelles. Dans un contexte où la sécurité, la lisibilité de l’espace et le confort visuel sont essentiels, le blanc pur devient tout sauf un allié.
Passer de blanc à vert a sauvé des vies
Heureusement, le blanc a depuis longtemps quitté la plupart des salles d’opération. Les chirurgiens ont été parmi les premiers à en constater les effets indésirables. Regarder du sang pendant des heures provoquait une fatigue oculaire importante et un effet de halo vert lorsque l’œil cherchait à compenser la couleur complémentaire du rouge. En 1914, au St. Luke’s Hospital de San Francisco, le chirurgien Harry M. Sherman a eu l’idée de peindre les murs en vert feuille d’épinard, la couleur complémentaire du rouge de l’hémoglobine, afin de soulager la vue du personnel médical. L’impact fut immédiat: moins d’éblouissement, une meilleure concentration et une endurance accrue pendant les interventions.
Mais cette innovation a surpassé la performance visuelle. On observa également des effets physiologiques positifs chez les patients, notamment une diminution de la tension artérielle et une sensation de calme. Le vert, symbole de nature, d’équilibre et de guérison, s’imposa dès lors comme une véritable révolution chromatique en milieu hospitalier.
La couleur au service de l’humain
Avons-nous réellement innové depuis ce changement qui a eu lieu il y a un siècle?
Il y a quelques années, j’ai reçu le mandat de coordonner la coloration de la nouvelle clinique Fertilys, à Brossard. Parmi toutes les pièces, c’est la salle d’échographie qui m’a le plus fait réfléchir. Comment choisir une couleur pour un lieu où tant d’émotions opposées se côtoient? Une salle où certaines femmes apprennent que leur traitement n’a pas fonctionné, que le cœur de leur bébé ne bat plus… mais où d’autres entendent, quelques minutes plus tard, la plus belle nouvelle de leur vie?
Impossible pour moi d’imaginer une couleur froide ou stérile pour cet espace. Le pêche s’est imposé naturellement: une teinte douce, chaleureuse et empathique. Elle enveloppe sans dominer, réconforte sans étouffer. Une couleur qui, à mes yeux, cochait toutes les cases: bienveillance, humanité, chaleur.
Une expertise encore trop sous-estimée
Quand je partage les recherches et réflexions qui se cachent derrière mes projets de coloration, les clients — comme les designers — sont souvent fascinés. Ils réalisent que la couleur n’est pas qu’une affaire d’esthétique: c’est une science appliquée, un levier de bien-être et de performance.
Dans un lieu aussi crucial qu’un milieu hospitalier, où chaque détail peut influencer l’état émotionnel, la concentration ou même la guérison, il est impensable que ce niveau de réflexion ne soit pas un standard.
À baS le blanc dans nos hôpitaux
Il m’arrive souvent de voir passer, sur mes réseaux sociaux ou ailleurs, des projets d’aménagement de cliniques — tout blancs, épurés, minimalistes, froids — et pourtant acclamés par la communauté du design. C’est beau, diront certains. Mais la beauté est subjective, et surtout, elle n’apporte rien à ceux qui y vivent ces espaces: les patients, le personnel, les familles.
La couleur, elle, va bien au-delà du beau. Elle soigne, elle soutient, elle humanise. Elle influence le moral, la concentration, la perception du temps et même certains marqueurs physiologiques. Dans un lieu où chaque émotion compte, où chaque détail peut faire la différence entre le réconfort et l’angoisse, la couleur n’est pas un accessoire: c’est un outil thérapeutique. Alors oui, à bas le blanc dans nos hôpitaux. Et si vous rêvez d’espaces qui inspirent confiance, douceur et humanité, entourez-vous de gens qui comprennent le langage des couleurs. Choisir les bonnes teintes pour ces lieux de vie et d’émotions, c’est une expertise à part entière. C’est la mienne, et j’en suis fière.
Envie que ça devienne la vôtre?!
Ma Formation Couleur Intensive revient pour une seule fois l’an prochain, à l’hiver 2026.
Suivie par plus de 200 personnes aux 4 coins du monde, les critiques sont unanimes: cette formation changera votre façon de voir le monde et d’intégrer la couleur dans vos projets.
Inscrivez-vous à la séance d’information gratuite pour tout connaître de cette formation et me poser vos questions en direct.